La grande sensiblerie
Imaginons qu’un Hellène, un Romain, un seigneur féodal, voire un de nos aïeux du dix-neuvième siècle, vienne…

Imaginons qu’un Hellène, un Romain, un seigneur féodal, voire un de nos aïeux du dix-neuvième siècle, vienne à converser avec un d’entre nous, hommes du bas-empire occidental. Que percevrait-il d’emblée ? Infiniment de choses, assurément, mais en voici une que nous ne voyons plus tant elle nous aveugle : notre grande sensiblerie. Nous sommes devenus de grands, d’immenses, d’insupportables sensibles entre temps. Nous faisons à présent tout dans le sentiment, partout, en permanence, et il faut l’admettre, ad nauseam. Nos valeurs ancestrales s’étant effondrées, n’adhérant plus à aucune vérité transcendante, redoutant désormais les discours exigeants sur l’Homme qui furent l’apanage des véritables humanistes, nous sommes contraints de mesurer, d’évaluer et de juger le monde humain et naturel selon un critère jadis méprisé par nos ancêtres : la sensibilité, qui glisse si aisément vers une sensiblerie envahissante. Yuval Noah Harari admet qu’elle est devenue l’ultime juge de paix de notre moralité dans son Homo Deus : « rien n’est mauvais sauf si quelqu’un en souffre ». « Quelqu’un », dit-il, fut-il n’importe qui. Pour bien comprendre notre époque, il faut ainsi réaliser que nous vivons sous la tyrannie de la sensiblerie du n’importe qui. Cela résume presque tout.
De fait, comment érigeons-nous notre actuelle échelle de valeurs ? Sur quel fondement établissons-nous notre morale, ou plutôt notre moraline ? Sur la sensibilité des uns et des autres, et pire encore, sur celle du premier venu. Est Mal ce qui fait du mal, est Bien ce qui fait du bien « à quelqu’un » : telle est notre affligeante doctrine postmoderne en matière d’éthique. Une chose est valorisée ou dépréciée selon la douleur ou le plaisir qu’elle engendre. Si elle cause des pleurs, frustre éventuellement, met à l’écart quelques individus, alors elle est jugée « mauvaise ». Au contraire, si elle caresse, susurre des paroles agréables, octroie le plus de droits possible, alors elle est « bonne », digne d’être célébrée. C’est pourquoi tous les hommes se valent bien, au fond, et valent bien peut-être les animaux, car un être n’a de valeur que dans ce qu’il ressent, que dans les sensations qu’il éprouve, que dans les réactions émotives dont il peut faire preuve. À ce niveau, un chimpanzé vaut bien un astronaute ; lui aussi peut avoir mal et se sentir malheureux après tout. La valeur n’est ainsi plus dans les hauteurs de l’esprit ; la valeur est dans le nerf, dans le nerf uniquement. Et ceux-ci sont à vif : la pleurniche a remplacé la prière dans notre quotidien. Il nous faut verser des larmes sur le sort des immigrés, des Africains, des réfugiés de guerre ou climatiques, des minorités en tout genre, des exclus, des dominés, des faibles, des petits, des hommes dans leur ensemble, en dépit de nos intérêts, en dépit de la raison, en dépit d’un Bien supérieure que l’homme devrait pourtant poursuivre, c’est-à-dire un Bien largement au-delà de petites et misérables considérations émotionnelles. De toutes manières, aucun Bien supérieur n’est envisageable en ces temps de grande sensiblerie, puisque toute exigence élevée établie des critères et des standards qui distinguent nécessairement les hommes et en excluent certains. Or, pareille manière d’être et d’estimer est inadmissible pour un sensible ; celui-ci ne peut donc qu’être un égalitaire, basant son critérium moral sur des ressorts émotionnels partagés par tous.
Dès lors, revenant de tout, nous, postmodernes, sommes retournés aux époques les plus primitives pour concevoir le Bien et le Vrai, car seul un sauvage ou au mieux un enfant conçoit des fragments d’éthique exclusivement par la douleur et le plaisir. Nous pourrions effectivement constater que nous sommes (re)devenus de petits enfants geignant seulement lorsqu’« ça fait mal » et lorsqu’« c’est méchant ». Nous le savons : un Occidental, c’est un ancien chrétien qui ne croit plus en Dieu ni au diable mais qui croit dur comme fer aux gentils et aux méchants. Ces derniers ne sont que ceux qui font souffrir et qui font pleurer : la grande sensiblerie qui caractérise notre époque est donc bien le symptôme d’un retour à l’enfance, mais celui, hélas, qui se remarque chez les petits vieux en fin de vie. Car l’homme qui n’évalue plus que sur des critères sensibles ne peut être qu’un homme malade, qu’un homme qui souffre, qu’un homme ayant à cœur de rester sur son lit d’hôpital le plus longtemps possible, n’attendant plus rien, sinon la mort et la morphine. C’est un vieillard.
Disons ici, au contraire ce qui révèle en général les âmes jeunes, vivantes et fortes : l’indifférence complète à l’égard de la sensibilité du moindre « humain », le mépris pour la sensiblerie larmoyante et médiocre, et la relégation, enfin, du plaisir et de la douleur dans les critères moraux. On veut plus et on veut mieux parce qu’on vaut plus et qu’on vaut mieux : que peut bien alors nous chaloir la sensibilité du moindre énergumène à la traîne, avec toutes ses émotions faciles ? Absolument rien.
En ces temps dangereux, il faut donc que l’Occidental grandisse, ou plutôt qu’il guérisse. On le remarquera surtout au fait qu’il arrêtera de pleurnicher pour un rien.
Partager sur
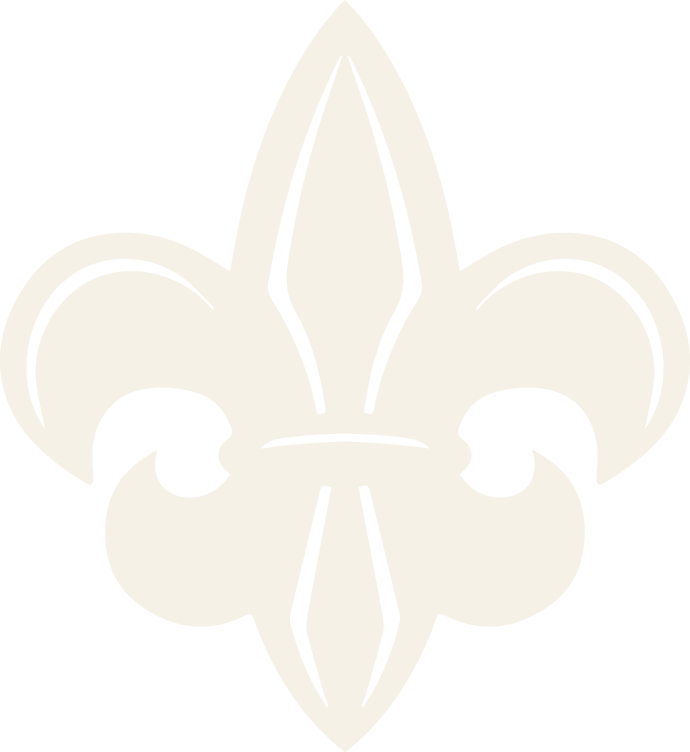

Éditions du Royaume
Hétairie devient Éditions du Royaume et étend la gamme de ses ouvrages à des auteurs étrangers traduits en français et disponible exclusivement sur notre site.


