À propos de mon livre Surhommes & Sous-hommes
Surhommes et Sous-hommes est un livre très ambitieux car il contient en réalité beaucoup de livres. À…

Surhommes et Sous-hommes est un livre très ambitieux car il contient en réalité beaucoup de livres.
À bien des égards, il en contient même trop.
Les deux premières parties (Qu’est-ce qui est inférieur ? & L’idéal aristocratique) auraient pu me servir pour écrire un livre sur l’Aristocratie, que j’aurais beaucoup vendu. Les deux suivantes (L’esprit du dressage & Aliénation et Nihilisme) auraient parfaitement pu constituer le cœur d’un petit essai sur l’éloignement progressif de l’homme vis-à-vis de sa nature comme processus historique ; petit essai que j’aurais moyennement vendu – soyons honnête – mais vendu quand même. La cinquième partie (Homo Babelus) aurait très clairement pu faire un petit best-seller tant le sujet est polémique : comment la postmodernité, la civilisation thermo-industrielle et le capitalisme actuel dégrade profondément le biocapital humain, ou pour le dire autrement, nous transforme littéralement en sous-hommes. La sixième partie (Futur(s) de l’Occident) aurait pu servir de support pour un petit livre sur l’avenir de notre civilisation, ou, mettons, pour une série d’articles. Enfin, la dernière partie (Biocivilisation) pourrait évidemment faire l’objet d’un livre à elle toute-seule : un essai sur l’écologie de droite ; celui que tous les gens s’intéressant un peu à ces questions attendent, certains avec impatience, d’autres de pied ferme.
Au lieu de cela, suivant mes propres observations sur l’âme aristocratique, j’ai voulu être profus. Beaucoup ont dit que ce livre était généreux. Il l’est sans aucun doute ; j’insiste pour dire qu’il l’est peut-être un peu trop. Attention, personne ne lui a reproché qu’il partait dans tous les sens ; non : toujours aristocratique, ce livre a du maintien. Il est en ordre. Le problème n’est pas là, je le répète : il veut juste en dire trop.
Et ceci est logique car j’avais précisément trop à dire à cette époque. Trop à dire sur des sujets apparemment distincts mais qui, dans mon esprit, étaient profondément liés. Il fallait que je parle des lois de la physique comme celles de la thermodynamique pour pouvoir juger de ce qui était indubitablement inférieur et supérieur (mon prologue). Puis il fallait que je les décrive en préambule, si puis dire, de ma conclusion (I et II). En somme, si vous aviez compris ce qui était supérieur non pas en fonction d’un simple jugement de valeur mais en rapport avec le fonctionnement même de l’univers, alors vous deviez tomber d’accord avec l’idéal de Biocivilisation qui se trouve à la fin. Juste après (III), je devais montrer que toute la culture humaine (et jusqu’au fameux « humanisme » dont on nous rebat les oreilles), voire du principe même de l’intelligence, était forcément le produit de ce que j’appelle des « projections-idéales », autrement dit un effort, une exigence, la volonté d’un but supérieur à soi-même, au donné, au « donné-là », à l’homme tout court. Par ce biais, je continuais de prouver mon point qui se trouve en conclusion : la culture et l’intelligence nous obligent, en quelque sorte, à vouloir une forme de civilisation supérieure, à vouloir ce que j’appelle la Biocivilisation. Mais il fallait maintenant (IV) que j’explique pourquoi celle-ci était si importante en elle-même, et pas seulement comme visée ou comme idéal lointain : car l’homme produisait naturellement du nihilisme à mesure qu’il s’aliénait, c’est-à-dire à mesure qu’il s’éloignait de sa nature. Or, ce nihilisme débouchait irrémédiablement sur le dernier homme qui allait mettre fin à toute aventure humaine supérieure, à toute civilisation, à toute évolution bien comprise. Alors, à partir de là (V), je pouvais évoquer les scenarii prévus pour nous autres Occidentaux et converser ainsi du futur. Comme chacun sait, il y a bien des chances que celui-ci ne soit pas très affriolant. Mais au-delà de la remarque un peu banale, nous pouvions enfin la comprendre dans toute son étendue en fonction de ce qui venait d’être décrit jusque-là (VI). Notre futur était compromis par ce que j’appelle une double défaite, celle de l’Esprit et celle de la Nature : celle qui consiste à avoir abandonné tout idéal supérieur, et celle qui, de concert, nous éloignait de nous-mêmes, fabriquant au passage des idées suicidaires et des hommes diminués. Du coup, la dernière partie (VII) venait comme la conclusion inévitable, comme la seule solution, comme la plus juste, la plus noble, la plus belle au fond : un nouveau rapport au monde devait être réclamé à l’Européen, un rapport « écologique » qui le guérirait en même temps qu’il s’évertuerait à guérir l’environnement des pollutions diverses dont son génie mal-employé était la cause.
Tout avait donc ainsi du sens dans cette grande histoire pleine d’idées qui, en apparence, auraient pu parfaitement se distribuer dans trois-quatre livres au lieu d’un. Voilà pourquoi j’ai trop dit – parce qu’en fait, il me semblait que je devais tout dire… Mais tout dire d’un coup, ce n’est pas toujours bien dire.
Il reste évidemment que ce livre est plaisant à lire, qu’il est intéressant, qu’il ouvre cent portes au lecteur pour penser de lui-même et qu’il lui est par conséquent, de toutes manières, très profitable. Même mes opposants me l’ont sincèrement confirmé à plusieurs reprises, ce dont je leur sais gré. Si vous voulez réfléchir au destin de l’homme et de notre civilisation, alors Surhommes et Sous-hommes vous sera hautement bénéfique, quelles que soient vos propres conclusions.
Pour conclure, je dirai ce qui fait son intérêt principal dans le monde des idées selon moi : son grand mérite est d’intégrer l’homme dans le processus entropique qu’une structure dissipative comme la civilisation (ou plutôt : la « mégamachine ») produit nécessairement. Nous savons déjà qu’elle dégrade l’environnement ; je dis qu’elle dégrade l’homme avec. Ce dernier est lui-aussi consommé telle une énergie, on pourrait dire qu’il s’use, ou qu’il en ressort profondément dégradé. J’intègre ainsi le biocapital humain à la deuxième loi de la thermodynamique et je crois être le premier à le faire aussi franchement. Au fond, l’idée que l’homme et la nature soient liés en raison d’une essence commune qui tient à l’évolution, et la conclusion qui veut que la plus grande culture – l’idéal aristocratique – consiste donc à forger une civilisation qui pourrait parfaire notre rapport à la Nature afin d’agir comme une néguentropie (réduction de l’entropie) non pas seulement autour de l’homme, mais en l’homme – toutes ces idées, disais-je, découlent naturellement de cette intégration de l’homme au processus entropique que je développe…
Permettez-moi de le redire encore une fois, légèrement autrement : le premier intérêt de ce livre dans le monde des idées (car je n’avais jamais vu jusqu’alors autant d’articulations conceptuelles entre la dégradation de l’environnement et la dégradation/aliénation de l’homme), est de montrer que l’entropie produit par notre structure sociale et économique agit sur la nature et sur l’homme. Cette dégradation humaine alors engendrée (génétique, biologique, intellectuelle, morale, esthétique etc.), largement constatable de nos jours, jouera en retour contre la structure elle-même, provoquant sûrement son effondrement si n’intervient pas un mouvement volontaire et féroce vers la grande santé écologique et anthropologiques, les deux étant indissociables.
Finalement, il n’est pas certain que son indéniable trop-plein soit vraiment un problème. L’outre remplie qui se déchire fait ainsi passer le philtre.
Julien Rochedy
Partager sur
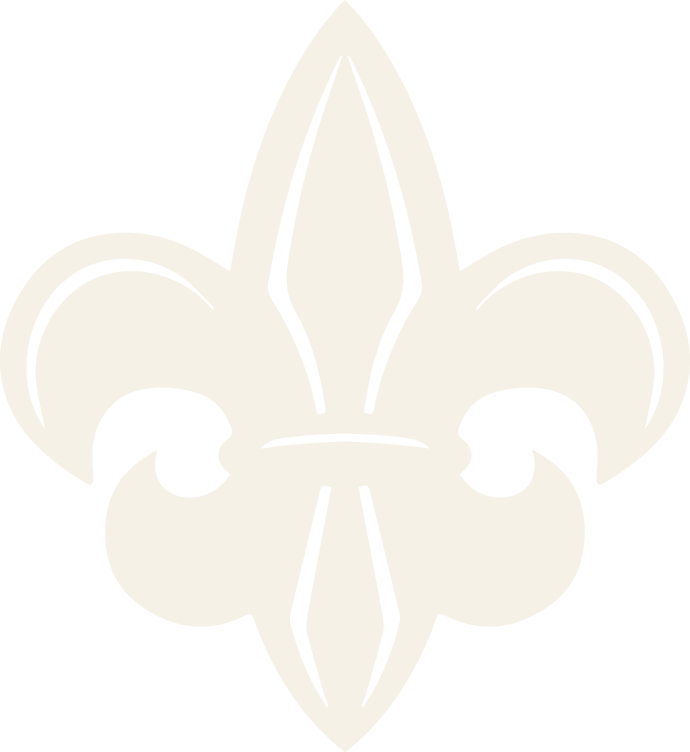

Éditions du Royaume
Hétairie devient Éditions du Royaume et étend la gamme de ses ouvrages à des auteurs étrangers traduits en français et disponible exclusivement sur notre site.


